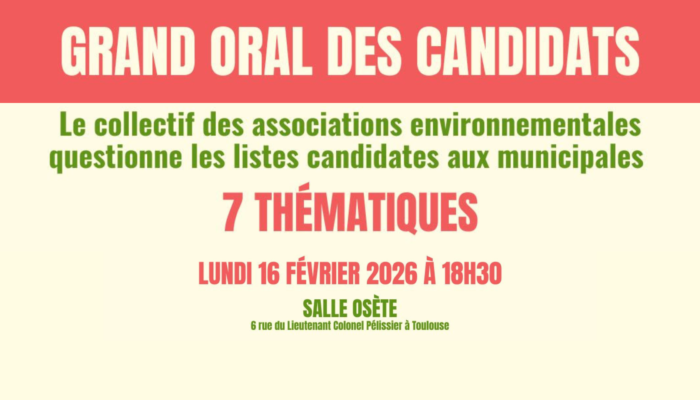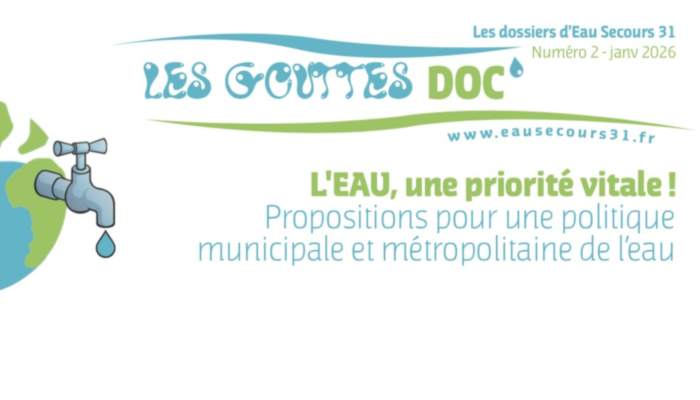🚧⚠️ : Si quelques pages manquent à l’appel et que des cases vides traînent dans une rubrique, pas de panique ! Le site est en reconstruction, tout en vous permettant d’accéder aux informations importantes !
Eau Secours 31
L’eau pour la vie, pas pour le profit !
Eau Secours 31 en quelques mots

Pourquoi l’eau, c’est un combat important ?
La situation actuelle en France
Un tiers des captages d’eau en France sont pollués, avec des pesticides détectés dans la majorité des nappes phréatiques et des cours d’eau, y compris des substances interdites depuis longtemps. Cette pollution chimique, provenant des rejets urbains, industriels et agricoles, altère profondément la qualité des eaux de surface et souterraines.
Comment cela nous impacte
Cette contamination menace la biodiversité aquatique en provoquant la mortalité d’espèces et l’eutrophisation des milieux, tout en exposant la santé humaine à des risques toxiques, microbiologiques et endocriniens. L’eau potable elle-même est affectée, contenant des polluants persistants comme le TFA, un herbicide aux effets durables.
Comment lutter ?
Pour préserver notre eau, il est essentiel d’agir sur les sources de pollution en favorisant des pratiques agricoles durables, en améliorant le traitement des eaux usées, et en sensibilisant chacun à la réduction des substances nocives. Ensemble, nous pouvons protéger cette ressource vitale à un prix juste pour tous en Occitanie !
Eau Secours 31 milite pour l’eau mais aussi avec d’autres associations environnementales !
nos
luttes
NOS
MOBILISATIONS